Ordre naturel ?
La question revient sans cesse, presque obsédante, toujours sans réponse : pourquoi, dans nos sociétés, et dans la majorité des civilisations humaines, les femmes sont-elles dominées par les hommes ? Comment s’expliquer, comprendre, que les êtres humains de sexe masculin ont pris possession et contrôle des êtres humains de sexe féminin ? L’expliquer par la différence de force physique ne nous satisfera qu’un instant. Porter, mettre au monde, et élever les enfants, voilà sans doute un modèle d’explication à la sédentarité et au confinement des femmes, mais qui ne justifie pas la domination et la violence dont elles pâtissent depuis des millénaires. Fallait-il les contraindre par la force à la procréation ? 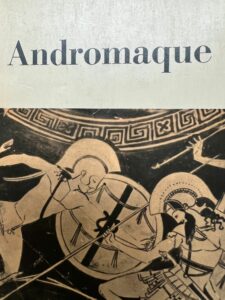 Peut-être, car, pendant des millénaires, grossesse et accouchement étaient dangereux pour les femmes. Si elles l’avaient pu, on imagine que, telles les Amazones, elles s’y seraient volontiers soustraites, au risque d’une extinction de la race humaine … Contraindre les femmes au confinement, à la sédentarité, voire les prendre de force pour assurer la procréation, est peut-être la seule façon que l’humanité a inventé pour ne pas disparaitre.
Peut-être, car, pendant des millénaires, grossesse et accouchement étaient dangereux pour les femmes. Si elles l’avaient pu, on imagine que, telles les Amazones, elles s’y seraient volontiers soustraites, au risque d’une extinction de la race humaine … Contraindre les femmes au confinement, à la sédentarité, voire les prendre de force pour assurer la procréation, est peut-être la seule façon que l’humanité a inventé pour ne pas disparaitre.
Dans certains lieux, quelques sociétés se sont développées selon un mode matrilinéaire dans lequel les hommes sont intégrés et non dominés, à l’inverse des sociétés patriarcales. Dans ces sociétés, l’égocentrisme, le narcissisme, s’effacent au profit du collectif.
Mais que vient faire la psychanalyse dans cette réflexion ? Nous nous demandons si la psychanalyse, inventée à la fin du XIX° siècle, période la plus patriarcale qui soit dans les sociétés occidentales, n’a pu qu’entériner un état de fait anthropologique.

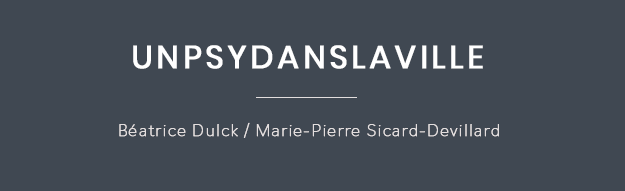
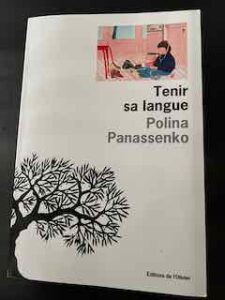 Et cette exploration commence à hauteur d’enfant, lorsque, fillette de cinq ans, elle est « lâchée » dans la cour d’une école maternelle qui n’est pas celle de sa langue, maternelle justement. La mère s’en va, laisse l’enfant : « quand je me retourne elle a disparu. En ce même instant tous les mots disparaissent. » Dès lors il n’y a que des sons. Polina Panassenko narre avec humour et néanmoins sensibilité son apprentissage du tissage des sons avec les mots qu’ils signifient. La puissance de ce livre tient pour une grande part à la faculté de revenir à l’expérience de l’enfant qui apprend à parler. Expérience oubliée pour la plupart d’entre nous, qui n’avons pas eu affaire à la nécessité d’un bi-linguisme, mais expérience forcément vécue car universelle.
Et cette exploration commence à hauteur d’enfant, lorsque, fillette de cinq ans, elle est « lâchée » dans la cour d’une école maternelle qui n’est pas celle de sa langue, maternelle justement. La mère s’en va, laisse l’enfant : « quand je me retourne elle a disparu. En ce même instant tous les mots disparaissent. » Dès lors il n’y a que des sons. Polina Panassenko narre avec humour et néanmoins sensibilité son apprentissage du tissage des sons avec les mots qu’ils signifient. La puissance de ce livre tient pour une grande part à la faculté de revenir à l’expérience de l’enfant qui apprend à parler. Expérience oubliée pour la plupart d’entre nous, qui n’avons pas eu affaire à la nécessité d’un bi-linguisme, mais expérience forcément vécue car universelle.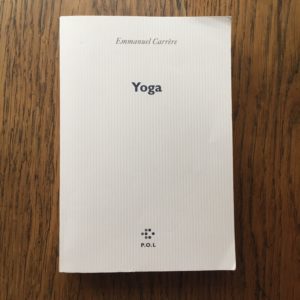

 Car l’environnement qu’il décrit est aussi désenchanteur et désenchanté que lui-même : monde d’inquiétudes et d’angoisses sociales, économiques, politiques, replié sur lui même et haineux. Les colères ne semblent plus pouvoir le sauver.
Car l’environnement qu’il décrit est aussi désenchanteur et désenchanté que lui-même : monde d’inquiétudes et d’angoisses sociales, économiques, politiques, replié sur lui même et haineux. Les colères ne semblent plus pouvoir le sauver. en effet question pendant l’heure et quelques minutes que dure le spectacle, et dans cet intervalle qui ne contiendrait au mieux que deux séances se déroule en accéléré l’essentiel d’une cure.
en effet question pendant l’heure et quelques minutes que dure le spectacle, et dans cet intervalle qui ne contiendrait au mieux que deux séances se déroule en accéléré l’essentiel d’une cure.
 la coïncidence de leur sortie en librairie. Au delà des causes des douleurs et de leur nature, ce qui différencie les deux récits de ces corps souffrants est sans doute la manière dont chaque protagoniste s’en empare, ou non.
la coïncidence de leur sortie en librairie. Au delà des causes des douleurs et de leur nature, ce qui différencie les deux récits de ces corps souffrants est sans doute la manière dont chaque protagoniste s’en empare, ou non.
