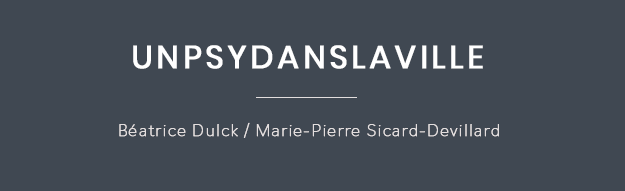Colère
L’agression meurtrière de passants par un homme qui se réclamait de l’Etat Islamique déclenche, comme souvent après des actes de cette nature, un fatras de réactions dont l’indigence de certaines nous met très en colère.
Le tollé fonce sur la psychiatrie, au motif que le meurtrier avait été pris en charge, dans son histoire, par des services psychiatriques. Quel amalgame ! La psychiatrie n’a pas vocation à soigner les idéologies. Décréter que l’islamisme est une pathologie mentale relevant de soins psychiatriques ? Trop facile ! Une manière de se mettre la tête sous l’oreiller et de ne pas voir ce que la société fait de brutal à certains, qui se réfugient dans les idéologies !

Accuser LA psychiatrie de « ratage », comme si la psychiatrie devait réussir ou rater, mais réussir ou rater quoi ? un examen ? un concours ? une mise au pas ? une normalisation ?